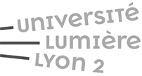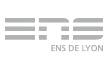Thomas Bonnet

Chercheur.e.s, enseignant.e.s-chercheur.e.s - Université Lyon 2
MCF
Équipe Travail, Institutions, Professions et Organisations
- t.bonnet@univ-lyon2.fr
- Lyon - Berthelot
Responsabilités pédagogiques
(co)responsable avec Magali Robelet du Master Sociologie et diagnostic des organisations (SDO) – Université Lumière Lyon 2 – UFR ASSP
Thèmes de recherche principaux
Sociologie du travail et des organisations / Emotions au travail et régulation sociale du risque émotionnel / Sociologie d’intervention / Sociologie clinique / Sociologie de l’activité
Recherches récentes ou en cours
2010-2016 : La régulation sociale du risque émotionnel au travail. Etude comparative dans les pompes funèbres, l’hôpital et la police – Recherche doctorale menée à l’université de Toulouse 2
2019-2023 : Recherche sociologique dans le milieu marchand de l’aide à domicile pour comprendre la dimension émotionnelle dans les risques professionnels – Recherche menée en collaboration avec l’INRS (Éric Drais)
2024-2026 : Les nouvelles temporalités juridiques et professionnelles du Code de la justice pénale des mineurs – Projet financé par l’IERDJ en collaboration avec Nadia Beddiar, Eudoxie Gallardo et Cédric Verbeck
Liste des publications
Ouvrage
– Bonnet, T., (2020), La régulation sociale du risque émotionnel au travail, Toulouse, Octarès
Numéro de revue (coord.)
– Bonnet, T., Drais, E., (dir), (2023), « Portées et limites du travail émotionnel pour interroger le travail et ses (dé)régulations », PISTES, n° 25, Vol. 1.
– Rochedy, A., Bonnet, T., (dir.) (2020) « Enquêter sur les affects : quels enjeux, quelles méthodes ? », Recherches qualitatives, Vol. 39, n°2, https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2020-v39-n2-rechqual05669/
Articles (revues à comité de lecture)
– Bonnet, T., Drais, E., (dir), (2023), « Editorial », PISTES, n° 25, Vol. 1. : https://journals.openedition.org/pistes/7825
– Drais, E., Bonnet, T., (2023), « Usure émotionnelle et conditions de travail dans le secteur de l’aide et des soins à domicile suite à la pandémie de Covid-19 », Références en santé au travail, n°174, p. 45-54. https://www.rst-sante-travail.fr/rst/pages-article/ArticleRST.html?ref=RST.TF%20308
– Bonnet, T., Primerano, J., (2022), « Les masques de la reconnaissance », Lien social et Politiques, n°88, p. 89-110.
– Bonnet, T., Drais, E., Lapoire-Chasset, M., Primerano, J., Rossignol, K., (2021), « Reconfiguration of the boundaries of occupational risk prevention observed during the COVID-19 pandemic : the case of personal protective equipment and collective protection in France”, Health, Risk & Society, DOI : 10.1080/13698575.2021.2003305,
– Rossignol, K., Primerano, J., Lapoire-Chasset, M., Drais, E., Bonnet, T., (2021), « Prévenir les risques au travail face à la Covid-19. Les masques comme moyens de protection individuelle et collective », Chroniques du travail, n°11
– Bonnet, T., Drais, E., (2021), « Comprendre les inégalités sociales de santé par la dimension émotionnelle du travail. Esquisse d’une typologie dans le secteur marchand de l’aide à domicile », Revue française des affaires sociales, n°4, p. 227-244.
– Bonnet, T., Drais, E., (2021), « Les tensions du travail d’articulation dans l’encadrement de l’aide à domicile. Le cas du secteur marchand face à une pénurie de ressources » Sociologies pratiques, n°42, vol. 2, p. 33-43.
– Bonnet, T., Rochedy, (2020), « De la (re)découverte des affects à l’affectivité limitée », Recherches qualitatives, Vol. 39, n°2, p. 1-14. https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2020-v39-n2-rechqual05669/1073506ar/
– Drais, E., Bonnet, T., (2020), « Former à la sécurité au travail : l’enjeu d’une culture organisationnelle de prévention. Illustration dans l’aide à domicile », Education permanente, n° 224, vol. , p. 105-114
– Bonnet, T., (2018), « Des émotions professionnelles dans la relation socio-éducative à l’hôpital et dans la police. Une construction collective et individuelle de l’intelligence émotionnelle », Sociétés et jeunesses en difficulté [en ligne], 20, mis en ligne le 30 septembre 2018, consulté le 12 octobre 2018 : URL : http://journals.openedition.org/sejed/8552
– Bonnet, T., (2018), « Ethnographie comparée du risque émotionnel au travail. Une tâche aveugle de l’agenda politique », Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 25, n° 3-4, p. 123- 149.
– Bonnet, T., (2018), « Officier ou ouvrier ? Les nouveaux officiers de police judiciaire français », Déviance et Société, vol. 42, n°1, p 113-139.
– Bonnet, T., (2016), « Apprentissages émotionnels. Le poids des collectifs de travail », La Nouvelle revue du travail, [En ligne], 9, mis en ligne le 02 novembre 2016, consulté le 07 novembre 2016. URL : http://nrt.revues.org/2911
– Bonnet, T., (2015), « La normalisation du rôle parental par une équipe soignante », Recherches familiales, n°12, p 223-234.
– Bonnet, T., Filion, N., (2014), « Formes et usages de la mémoire dans la construction de l’éthos professionnel », Sociologies pratiques, n°29, vol 2, p 83-91.
Chapitre d’ouvrage
– Bonnet, T., (à paraître 2023), « Jusqu’où aller ? Engagement et ethnographie de l’hôpital, des pompes funèbres et de la police », in Cohen, P., Monjaret, A., Rémy, E., Sirost, O., (dir), Ethnographies et engagements, Rouen, PURH.
– Drais, E., Bonnet, T., (2022), « La contractualisation émotionnelle et ses ambivalences au cœur de l’aide à domicile », in Burnay, N., (dir), Sociologie des émotions, Louvain-la-Neuve, De Boeck.
– Bonnet, T., Rochedy, A., (2021), « Regard croisé sur l’épreuve affective du terrain. Analyse des affects et chercheur.e.s affecté.e.s », in Héas, S., Zana, O., (dir), Les émotions dans la recherche en sciences humaines et sociales, Rennes, PUR, p. 157-173.
– Bonnet, T., (2016), « La réquisition de police : L’acmé du sale boulot dans les pompes funèbres », in Memmi, D., Raveneau, G., Taieb, E., (dir), Le social à l’épreuve du dégoût. Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 45-55.
Rapport de recherche
– Drais, E., Bonnet, T., (2020), Note de synthèse sur la culture organisationnelle de prévention, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des risques professionnels, 12 p.
– Bonnet, T., (2015), « Le collectif de travail face au risque émotionnel », Rapport de recherche, Certop ; Université de Toulouse Jean Jaurès, 107 p.
Colloque avec actes
– Bonnet, T., (2017), « Un engagement à risque émotionnel ? Ethnographie de l’hôpital, des pompes funèbres et de la police », Ethnographies plurielles # 7, Ethnographies et engagements, colloque des 9 et 10 novembre 2017, Mont-Saint-Aignan. https://hal.archives-ouvertes.fr/NIMEC/hal-01885013
Compte-rendu de lecture
– Bonnet, T., (2023), compte-rendu dans Sociologie du travail, Vol. 65. n°3, (Régine Bercot, Aurélie Jeantet, Albena Tcholakova, 2022, Emotions, travail et sciences sociales, Toulouse, Octarès, 198 p.)
– Bonnet, T. (2019), compte-rendu dans la Revue française de sociologie, n° 60. Vol.2, (Aurélie Jeantet, 2018, Les émotions au travail, Paris, Editions du CNRS, 326 p.)
Communications
Conférencier invité
– Bonnet, T., (2023), « Quand on croise les émotions », Semi-plénière de l’AFS avec Bresson, J., Flandrin, L., Thomé, C., animée par Hommel, E., Jegat, L., Lyon.
– Bonnet, T., (2023), « Émotions, travail émotionnel : quel intérêt pour les chercheurs en SHS ? », invité au séminaire transversal du CERTOP, Toulouse.
– Bonnet T., (2021), « Le risque émotionnel dans les soins : enjeux théoriques et méthodes en pédiatrie et dans l’aide à domicile », invité à communiquer au séminaire sur la thématique de "l’étude des émotions dans le secteur de l’aide et du soin selon différentes approches", du réseau Association pour la Recherche en Psychologie Ergonomique et Ergonomie (Arpège), Paris
– Bonnet, T., (2020), « La régulation sociale du risque émotionnel au travail », Invité à présenter l’ouvrage aux 6½ du Réseau Recherche Scientifique pour l’Amélioration des Conditions de Travail (Resact-MP), Toulouse
– Bonnet, T., (2018), « La régulation sociale du risque émotionnel au travail : du concept à la méthode de recueil de données », invité au séminaire doctoral concept et méthodes pour conduire des recherches associant organisation, travail réel et santé, Toulouse
– Bonnet, T., (2017), « Officier ou ouvrier ? Les nouveaux officiers de police judiciaire français », invité à présenter l’article primé au concours jeunes chercheurs organisé par la revue Déviance et Société à un colloque international, Paris.
– Bonnet, T., (2017), « Le risque émotionnel, une condamnation théorique des émotions au travail ? », invité au colloque Réinterroger la pertinence de la notion de risque pour aborder la santé au travail et le travail, Paris.
Colloques
– Bonnet, T., (2024), « La reconnaissance masquée des aides à domicile durant la pandémie de Covi-19 en France », CR 15 (sociologie du travail), XXIIe Congrès international des sociologues de langue française, AISLF, Ottawa.
– Bonnet, T., Drais, E., (2024), « Murmurer à l’oreille (sourde ?) des décisionnaires : réflexion sur la sociologie d’intervention », CR 16 (sociologie professionnelle), XXIIe Congrès international des sociologues de langue française, AISLF, Ottawa.
– Bonnet, T., Drais, E., (2024), « Le travail émotionnel au cœur de l’étude des émotions par les sciences du travail. Revue de littérature et perspectives critiques », GT 07 (émotions et société), XXIIe Congrès international des sociologues de langue française, AISLF, Ottawa.
– Bonnet, T., (2023), « Division émotionnelle du travail ou division du travail émotionnel ? Comment comprendre la spécialisation émotionnelle au sein des collectifs de travail ? », Colloque Le travail émotionnel des hommes, Université Paris Dauphine.
– Drais E., Bonnet, T., (2021), « Le travail émotionnel comme moyen de saisir l’expérience des atteintes à la santé et l’engagement en prévention. Un exemple dans l’aide à domicile », RT 19 (Santé, médecine, maladie et handicap), 9e congrès de l’AFS, Lille (à distance).
– Bonnet, T., (2021), « Comment la dimension émotionnelle du travail permet de comprendre les inégalités sociales de santé ? Le cas du secteur marchand de l’aide à domicile. 1er Symposium international FAB.ISS, Toulouse (à distance).
– Bonnet, T., Rochedy, A., (2018), « Introduction à la conférence plénière de Jean Peneff », Biennale d’ethnographie de l’EHESS, Paris
– Bonnet T., Rochedy, A., (2018), « Introduction et animation de l’atelier « Être affecté.e / Observer et décrire des affects », Biennale d’ethnographie de l’EHESS, Paris
– Bonnet, T., (2017), « Les collectifs de travail, un pouvoir de décision collectif ? », RT25 (Travail, Organisations, Emploi), 7e congrès de l’AFS, Amiens.
– Bonnet, T., (2016), « Le collectif de travail face au risque émotionnel : une régulation sociale routinière ? », XXe congrès de l’AISLF, Montréal.
– Bonnet, T., (2013), « La soignante, l’enfant… et le parent », CR 08 de l’AISLF, « autour de l’enfant », Lausanne.
– Bonnet, T., (2013), « L’acmé du « sale boulot » dans les pompes funèbres : les réquisitions de police », 5e congrès de l’AFS, Nantes.
– Bonnet, T., (2012), « Le travail émotionnel comme facteur de risque dans les professions à risques émotionnels, quelle régulation possible », XIXe congrès de l’AISLF, Rabat
Séminaires
– Bonnet, T., Drais, E., (2022), « Histoire d’une collaboration autour d’une sociologie des émotions », Séminaire de l’équipe TIPO du Centre Max Weber, Lyon.
– Bonnet, T., (2021), « Réflexion autour de l’engagement émotionnel des aides à domicile pour comprendre leur exposition aux risques professionnels », Séminaire transversal du Centre Max Weber, Lyon.
– Bonnet, T., (2020), « Les émotions dans le travail par l’approche du risque émotionnel », Séminaire de l’équipe dispositions, pouvoir, cultures et socialisations du Centre Max Weber à l’ENS Lyon.
– Bonnet, T., (2015) « Le travail relationnel et le travail d’organisation : un apprentissage collectif du travail », Séminaire « Penser et produire le travail relationnel », Les journées « Travail » du CERTOP-CNRS.
– Bonnet, T., (2015) « Le risque émotionnel : quand l’émotion perturbe le travail », Speed-searching pour les 20 ans du CERTOP, Université Toulouse Jean Jaurès.
– Bonnet, T., (2013), « La socialisation technique, relationnelle et émotionnelle dans les pompes funèbres et à l’hôpital », Séminaire du pôle SPOT, CERTOP, Université Toulouse 2, Le Mirail.
– Bonnet, T., (2012), « Le travail émotionnel comme facteur de risque dans les professions à risques émotionnels, quelle régulation possible ? », séminaire du pôle SPOT, CERTOP, Université Toulouse 2, Le Mirail.
Dans les médias
– 2020- interviewé par Benoît Zittel pour Anthropie. https://feeds.podcastics.com/podcastics/podcasts/rss/855_e194b5b5b5053261731198889531fa90.rss
– 2020 – interviewé par Joëlle Maraschin pour Actuel HSE sur la sortie de l’ouvrage La régulation sociale du risque émotionnel au travail. https://actuel-hse.fr/content/interview-thomas-bonnet-le-risque-emotionnel-est-invisible-pour-lorganisation-du-travail
– 2019 – Interviewé par Chris Bockman pour la BBC « News report on police suicides in France » diffusé le 4-12-2019.
Dernières publications
2026
- Autres publications HAL Nadia Beddiar, Eudoxie Gallardo, Thomas Bonnet, Cédric Verbeck, 2026
2024
- Article HAL Éric Drais, Thomas Bonnet, Éditorial, Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la Santé, volume 26-1, 2024
2023
- Article HAL Eric Drais, Thomas Bonnet, Usure émotionnelle et conditions de travail dans le secteur de l’aide et des soins à domicile suite à la pandémie de Covid-19, Références en santé au travail, n°174, 2023, p. 45-54
- Article HAL Thomas Bonnet, Éric Drais, Portées et limites du travail émotionnel pour interroger le travail et ses (dé)régulations. Éditorial, Perspectives Interdisciplinaires sur le Travail et la Santé, volume 25, n°1, 2023
2022
- Article HAL Thomas Bonnet, Julie Primerano, Les masques de la reconnaissance. The Work of Home Care Aides During the COVID-19 Health Crisis, Lien social et Politiques, n°88, 2022, p. 89-110
- Article HAL Thomas Bonnet, Éric Drais, Comprendre les inégalités sociales de santé par la dimension émotionnelle du travail. Esquisse d’une typologie dans le secteur marchand de l’aide à domicile, Revue française des affaires sociales, n°4, 2022, p. 227-244
2021
- Article HAL Thomas Bonnet, Eric Drais, Mireille Lapoire-Chasset, Julie Primerano, Karen Rossignol, Reconfiguration of the boundaries of occupational risk prevention observed during the COVID-19 pandemic: the case of personal protective equipment and collective protection in France, Health, Risk and Society, volume 23, n°7-8, décembre 2021, p. 339-358
- Article HAL Thomas Bonnet, Eric Drais, Les tensions du travail d’articulation dans l’encadrement de l’aide à domicile. Le cas du secteur marchand face à une pénurie de ressources, Sociologies pratiques, n°42, 2021, p. 33-43
- Article HAL Karen Rossignol, Julie Primerano, Mireille Lapoire-Chasset, Eric Drais, Thomas Bonnet, Prévenir les risques au travail face à la Covid-19. Les masques comme moyens de protection individuelle et collective, Chroniques du Travail, n°11, 2021, p. 35-58
- Chapitre d’ouvrage HAL Thomas Bonnet, Amandine Rochedy, « Regard croisé sur l'épreuve affective du terrain. Analyse des affects et chercheurs affectés » in Stéphane Héas (dir.), Les émotions dans la recherche en sciences humaines et sociales. Épreuves du terrain, Presses Universitaires Rennes, 2021, p. 153-157 [voir]