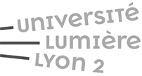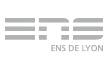Résumé :
Si l’aide désigne une action ordinaire dans la vie courante, elle est progressivement devenue dans les sociétés francophones une catégorie d’action publique, désignant les services rendus de manière routinière dans la sphère privée aux personnes ayant besoin de soins de longue durée, d’accompagnement et de soutien pour faire face à des difficultés, notamment de santé, ou des handicaps durables qui affectent leur vie quotidienne. Au Québec, l’aide et les personnes proches aidantes sont au coeur de différentes politiques depuis les années 1980. Dans le champ du vieillissement, et plus particulièrement dans les politiques de soutien à domicile, les solidarités familiales sont interpellées dès 1985 dans la prise en charge des proches, l’État invoquant que son intervention, jusqu’ici trop marquée, risque de créer trop de dépendance envers lui (Guberman et Lavoie, 2012 ; Grenier, Marchand et Bourque, 2021). La capacité de l’État de fournir de l’aide à sa population dans un Québec vieillissant devient ainsi objet de préoccupation politique, laquelle servira de toile de fond au virage ambulatoire des années 1990, c’est-à-dire au processus de décentralisation des services étatiques, tant dans le domaine de la santé mentale que dans ceux du vieillissement et du handicap, pour privilégier les milieux de vie, le communautaire/associatif, les services privés et la famille. Par ce « changement paradigmatique des fonctions providentielles de l’État » québécois (Lesemann, 2002 : ix), les familles deviennent des acteurs incontournables dans la dispensation de l’aide, voire des « partenaires » (Lesemann, 2001). En 2003, l’adoption d’une politique de soutien à domicile, Chez soi : le premier choix, vient entériner ce que Lesemann qualifie de « changement paradigmatique des fonctions providentielles de l’État » (2002 : ix). Au gré des politiques, le gouvernement orchestre ainsi les services d’aide en établissant les devoirs et les tâches de plusieurs acteurs (Lavoie et Guberman, 2010), en (re)définissant les modes de relation entre les personnes proches aidantes et le système de santé et de services sociaux (Grenier, Marchand et Bourque, 2021). Les personnes proches aidantes sont officiellement reconnues par la loi dans la première politique nationale en matière de proche aidance en 2021. En France, plus encore que l’aide, ce sont les aidants qui ont été constitués en catégorie et en public cible de politiques : ainsi, la politique de soutien aux aidants qui s’est formalisée depuis les années 2000 en France reconnaît cette activité de soutien et d’accompagnement des personnes vulnérables dans deux secteurs principaux, la vieillesse et le handicap. Différentes lois (loi Allocation personnalisée d’autonomie en 2000, loi Handicap en 2005, loi HPST [Hôpital, patients, santé, territoires] en 2009) instaurent une reconnaissance, puis précisent un véritable statut d’aidant (Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement en 2015), visibilisant l’aide apportée au quotidien à un proche (Giraud et Le Bihan-Youinou, 2022). La galaxie des aidants – familiaux, profanes, informels – est ainsi de mieux en mieux décrite et analysée, tant dans les milieux socioprofessionnels du handicap ou de la gérontologie que dans la littérature scientifique (Giraud, Outin et Rist, 2019 ; Campéon, Le Bihan-Youinou, Mallon et Robineau-Fauchon, 2020 ; Amyot, 2021 ; Gimbert et Giraud, 2022). Ces travaux ont contribué à dénaturaliser l’aide comme à mieux comprendre la place et la condition des personnes proches aidantes, entre solidarités privées et solidarités publiques, entre protection « rapprochée » (Castel, 1991 ; Lesemann et Martin, 1993) et protection sociale, entre bricolages familiaux et aides professionnelles. Alors que durant les années 1960 à 1980, une défamilialisation de l’aide et du soutien aux personnes âgées et handicapées (Giraud et Le Bihan-Youinou, 2022) a été opérée, le passage à une croissance ralentie à partir des années 1980 …
En savoir plus : l’introduction est disponible en ligne sur l’éditeur