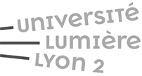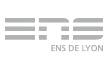Introduction :
La question des pénuries de main-d’œuvre a occupé une place importante dans le débat public à la sortie de l’épidémie de Covid-19, notamment à partir de l’automne 2020 et tout au long de l’année 2021, lorsque l’éventualité d’une reprise économique d’ampleur se concrétise [1]. Les discours sur les « pénuries » sont très nombreux, mais ne s’appuient que rarement sur une objectivation des situations pointées ou de leurs causes [2]. L’absence d’objectivation et le flou des discours sont perceptibles également si l’on s’intéresse à la dimension sémantique. La notion de « pénurie » a occupé en 2020 et 2021 le devant de la scène, mais d’autres notions sont parfois mobilisées : « métiers en tension », « tensions de recrutement », « difficultés de recrutement », « emplois vacants ». Cette multiplicité de termes révèle un certain flottement dans les usages d’une part (parle-t-on de la même chose ?) et l’absence de réflexion empirique d’autre part (comment ces “pénuries” ou “tensions” se concrétisent-elles ?). De manière relativement courante dans le champ de l’emploi, la construction par une coalition d’acteurs et d’actrices hétérogènes d’un problème public en matière économique se fait en l’absence d’une objectivation du réel [Zune, 2014a].
En savoir plus : article disponible sur Cairn (accès authentifié)