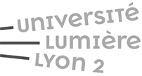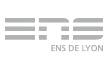Alexis Colin

Doctorant.e.s - Université Lumière Lyon 2
Équipe Politiques de la connaissance
- alexis.colin2@univ-lyon2.fr
- Lyon - Campus de Bron
Travailleur social pendant 14 ans, j’ai d’abord réalisé une première enquête ethnographique (dans le cadre d’un Master Anacis), entre janvier 2021 et novembre 2023, sur les interactions et pratiques de soutien autour de la santé de réfugié(e)s.
Depuis janvier 2025, j’ai débuté une thèse sur le soutien en santé mentale des personnes migrantes dans le Briançonnais.
Résumé du projet de thèse :
Depuis 2016, le Briançonnais est un point de passage pour les personnes migrantes qui viennent de traverser la frontière franco-italienne. Cet espace-frontière est également un point d’ancrage pour certains migrants qui doivent ou décident d’y rester. Exposées aux violences et aux traumatismes, ces personnes voient leur état de santé se dégrader progressivement au cours du parcours migratoire et une fois arrivés dans le pays d’accueil. La prévalence de détresse psychologique est plus importante pour les migrants que pour la population générale, ce qui fait de leur prise en charge en matière de santé mentale un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, cette prise en charge fait défaut. L’accès des personnes migrantes aux dispositifs de soin psychique dits de « droit commun » est empêché et l’offre saturée. Dans ce contexte, la santé mentale s’étend au-delà des frontières du sanitaire et des institutions hospitalières et déborde largement le champ de la psychiatrie et de la maladie. Un transfert de charge s’opère alors vers d’autres champs. Cette recherche a pour but de décrire et d’explorer les transformations, les nouvelles configurations et formes du soutien en santé mentale qu’occasionne la présence de personnes migrantes sur le territoire Briançonnais, dans un contexte où les « spécialistes » de la santé mentale sont souvent indisponibles. En m’intéressant de près aux interactions et aux expériences que partagent migrants et aidants (bénévoles d’associations, travailleurs médico-sociaux, interprètes, pairs,etc), je cherche à décrire de nouvelles configurations et modalités du prendre soin, entendu dans une acception large qui relève du paradigme de l’attention et donc des pratiques de care. L’approche interactionnelle est privilégiée afin d’obtenir un niveau de granularité très fin, pour rendre compte des multi-modalités sensibles de ces pratiques. Les pratiques d’attention et de soutien à la santé mentale des migrants forment un champ de recherche encore peu investi en sciences humaines et sociales. En se centrant sur une approche interactionnelle du travail de care, approche interdisciplinaire peu commune en la matière, et en articulant sociologie de la migration et sociologie de l’hospitalité, le présent projet entend contribuer au renouvellement de la sociologie de l’intervention sociale et de la santé des migrants. Dans un premier temps, à partir des expériences vécues des personnes migrantes et de différents points d’ancrage (CADA, services médico-sociaux, associations et collectifs militants, etc), je cherche à comprendre les formes et pratiques diversifiées du soutien des migrants, leurs conditions d’émergence et leur inscription comme milieux. En construisant avec les personnes migrantes leurs trajectoires et pérégrinations, je souhaite identifier leurs réseaux d’attachements et dresser ce que l’on pourrait appeler des constellations du soutien. Quels lieux et objets (humains, non humains) font ressources pour les migrants en soutien aux problématiques de santé mentale qu’ils rencontrent ? Dans un second temps, je cherche à décrire les différentes facettes de la prise en considération de la santé mentale des migrants, en tenant compte de l’expérience vécue et des pratiques de l’ensemble des acteurs concernés. D’un côté, les « aidants » s’impliquent dans la prise en charge des besoins en santé mentale des migrants et cherchent à corriger la dimension iatrogène de l’accueil. D’un autre côté, ils doivent satisfaire à d’autres besoins du public et aux contraintes de leur mandat (accompagnement aux démarches administratives, gestion du collectif, etc), dans des temporalités incertaines. Cette recherche entend explorer les différentes tensions et épreuves qui peuvent apparaitre dans la relation d’aide. En d’autres termes, je cherche à voir comment les aidants passent du paradigme de l’accueil ou de l’accompagnement à celui du soutien en santé mentale, à travers l’identification des pratiques (notamment attentionnelles et émotionnelles) qu’ils mettent en jeu dans ces espaces relationnels.
Dernières publications
2025
- Communication HAL Alexis Colin, « Soutenir la santé mentale des personnes migrantes. Circonstances et conditions de félicité pour un écosystème de parole et d'écoute. », Colloque international interdisciplinaire du GIS Hybrida-IS : Humaniser le travail social ? Des métiers en dilemmes et en (re)configurations, Fribourg (Suisse), août 2025
- Article HAL Alexis Colin, Soutenir la santé mentale des personnes migrantes : quelques questionnements éthiques et pratiques autour des interventions de travailleurs sociaux dans le Briançonnais, FORUM, volume n° 175, n°2, juillet 2025, p. 33-48